Deux siècles après la retraite de Russie, l’écrivain Sylvain Tesson a suivi en 2012 l’itinéraire des grognards, avec quatre amis. Berezina mêle le récit de ce périple en side-car et les horreurs de l’épopée napoléonienne.
Son texte déboule comme un torrent. Sylvain Tesson décrit à fond les gaz son improbable chevauchée, de Moscou à Paris. Avec une fine équipe d’«ouralistes-radicalistes-napoléonistes», l’auteur de Dans les forêts de Sibérie a retracé en side-car la route de la retraite de Russie, deux siècles tout juste après l’armée de Napoléon. De ces treize jours et 4000 kilomètres dans la neige et le blizzard, l’écrivain-voyageur a tiré ce Berezina fougueux et jubilatoire.
L’idée de ce voyage naît de l’ennui, à bord d’un voilier naviguant entre les icebergs, au large de la Terre de Baffin. Avec Cédric Gras, un ami géographe, Sylvain Tesson rêve, un soir, de renouer avec un vrai voyage. C’est-à-dire? «Une folie qui nous obsède, nous emporte dans le mythe; une dérive, un délire quoi, traversé d’Histoire, de géographie, irrigué de vodka, une glissade à la Kerouac, un truc qui nous laissera pantelants, le soir, en larmes sur le bord d’un fossé.» Voilà pour la définition du voyage, vu par Tesson.
Invité au Salon du livre de Moscou, il décide donc de rentrer à Paris sur une moto préhistorique. Avec Cédric Gras et le photographe Thomas Goisque, bientôt rejoints par leurs amis russes Vitaly et Vassili, les voici sur une Oural de conception soviétique. Une de ces machines totalement dépourvues d’électronique, qui plafonnent à 80 km/h et donnent l’impression «de se tenir à cheval tout en barrant un chalutier».
Increvables, ces engins, puisque «n’importe qui peut les réparer avec une pince en métal». Au moment du départ, Sylvain Tesson s’exclame, superbe: «Les gars! Rien n’arrêtera notre Oural, pas même ses freins!»
Bicorne au vent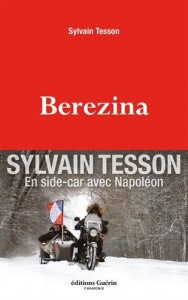
Sur le panier, un bicorne et le drapeau de la garde impériale. Départ de Moscou le 2 décembre. Il fait –17°C. «Le doute s’immisçait en moi: que foutais-je sur cette Oural en plein mois de décembre avec deux zouaves embarqués, alors que ces engins du diable sont conçus pour convoyer de petites Ukrainiennes de quarante-six kilos par des après-midi d’été, de Yalta-plage à Simferopol?» A la question «pourquoi ce voyage?» il avait répondu, quelque temps auparavant: «Pour le panache, chérie, pour le panache.»
Il a la gueule de la boue et de la neige, le panache. L’haleine des gaz d’échappement que crachent les camions frôlant cet invraisemblable équipage. Sylvain Tesson excelle à dire ces routes sales, ces visières que les gants ne parviennent pas à essuyer, ces couches de vêtements qui ne suffisent jamais à se protéger du froid. A lire ses phrases qui claquent dans le gel, on grelotte avec les motards, on se réchauffe à la vodka au poivre, on se marre aussi, devant leurs mésaventures affrontées avec fatalisme.
Le goût du tragique
L’écriture charme également par ce mélange de langage relâché et de tournures désuettes, du style «Ney s’opiniâtra à défendre l’honneur, et, contenant les Russes, guéa le fleuve en dernier…»
Dans ce style très personnel, Sylvain Tesson trouve les mots pour dire son amour des Russes, «leur goût du tragique, leur sens du sacré, leur inaptitude à l’organisation, cette capacité à jeter toutes leurs forces par la fenêtre de l’instant, leur impulsivité épuisante, leur mépris pour l’avenir et pour tout ce qui ressemblait à une programmation personnelle». Ce voyage va ainsi sceller «l’amour de la Russie, des routes défoncées et des matins glacés lavant les nuits d’ivresse».
Mais la réussite de Berezina réside aussi dans l’évocation de l’apocalyptique épopée napoléonienne, qui alterne avec le récit de ce voyage empli d’autodérision. Le livre rend atrocement présents ces soldats et ces chevaux rongés de froid, de fatigue et de faim, mourant par milliers chaque jour.
L’horreur croît au fil des pages et des souffrances inhumaines d’une armée de zombies bouffés par les poux, qui tentent de survivre en mangeant leurs chevaux, en suçant des glaçons de sang. Un témoin de l’époque a rapporté cette scène de «quatre hommes, les mains et les jambes gelées, mais l’esprit encore vif, et deux chiens qui leur dévoraient les pieds».
«On est dans le mythe, les gars!»
Dans l’imaginaire collectif comme dans celui de nos aventuriers en side-car, le principal symbole de cette débâcle reste la Bérézina. «On est dans le mythe, les gars, on est dans le mythe. On n’a jamais été autant dans le mythe», répète le photographe Thomas Goisque en découvrant les lieux.
La rivière de malheur, ce jour-là, ressemble à «un cours d’eau aimable, indécis, dont les méandres avaient les reflets du mercure». Avec son sens de la formule, Sylvain Tesson résume: «C’était le théâtre de l’apocalypse et on aurait cru le Loiret.» Suit le récit de la traversée d’une armée exsangue. Une victoire pour un Napoléon qui a berné l’ennemi.
Au passage, l’écrivain rétablit en effet une vérité historique: le nom de la rivière a pris le sens que l’on sait, alors que «si l’on se conformait à la pure réalité des faits, “c’est la bérézina” aurait dû signifier “on l’a échappé belle, les gars, on l’a senti passer, on a laissé des plumes, mais la vie continue et merde à la reine d’Angleterre”.»
La fin du destin commun
L’extraordinaire vitalité de ce roman s’apaise parfois pour laisser place à la réflexion. Au bout du voyage, Sylvain Tesson s’interroge sur la force mystérieuse qui a poussé ces soldats à suivre l’Empereur. Sur le sens du collectif, aujourd’hui disparu: «Nous avions perdu nos nerfs. Quelque chose s’était produit depuis l’après-guerre. Le paradigme collectif s’était transformé. Nous ne croyions plus à un destin commun.»
Dans une récente interview, une des premières données depuis son accident d’août dernier (une chute d’un toit, dix jours de coma, une vingtaine de fractures…), l’écrivain rappelait ainsi que, aujourd’hui, même quand on veut montrer sa solidarité, l’individualisme prime: on dit «JE suis Charlie». Il appelle ça «la maladie de la célébration de l’individu, initiée par les nouvelles technologies». Nous sommes entrés dans une époque où, «l’objectif n’était pas la gloire, mais le droit à un pavillon recevant la 5G».
Sylvain Tesson, Berezina, Editions Guérin, 208 pages
Reportage photos de Thomas Goisque sur le périple: http://www.thomasgoisque-photo.com/site.php?page=reportages&spec=avent&id=113#















